
La main et
l'oeil
Qu'est-ce qu'un auteur de film?
par François Jost
Si les années 80 ont été marquées, du point de vue théorique, par l'étude de l'énonciation cinématographique, elles l'ont été aussi, d'un autre point de vue, par le retour d'un courant critique soucieux des oeuvres, de leur genèse comme de leur esthétique. Tandis que les uns - sémiologues, narratologues, peu importe le nom qu'on leur donne - continuaient sur la lancée des années 60 à refuser toute instance anthropomorphisante, laissant l'auteur à la porte de leurs bâtisses théoriques, les autres favorisaient son retour par la fenêtre en se penchant sur une pluralité d'oeuvres réunies sous un seul nom.
Paradoxe: c'est celui qui avait le plus fortement lutté contre ce que l'idée d'auteur recouvrait d'autorité et de hiérarchie jusqu'à se fondre dans le "Groupe Dziga Ver-tov", qui, en un sens, relança le mouvement. Depuis une décennie, les articles ou les monographies sur Godard se sont multipliés, non sans au départ une certaine gêne, sensible dans cette introduction de la Revue belge du cinéma: "L'objectif du numéro n'a jamais été, comme dans tant de revues et de publications récentes, de poser les éternelles questions journalistiques sur le nom propre, sur l'individu Godard, sur ses attitudes et comportements, ses déclarations et provocations, son image de marque et ses rapports aux médias [...] Cette livraison a en fait pour seul objet l'ensemble des films et vidéos de Jlg tels qu'ils sont, dans leur réalité interne autant qu'externe". (1)
Manifestement, le préfacier a bien conscience de ce qu'il fait, même s'il le dénie: certes, il gomme le nom propre et l'individu en leur substituant des initiales (qui sont, précisément, son image de marque puisqu'elles donnent son nom à la société de production de Godard), mais il ne va pas jusqu'à remettre en cause le fait que la multiplicité des films et des vidéos (malgré la distance temporelle qui les sépare, l'hétérogénéité des conditions de leur production et de leurs supports) forment un ensemble.
Depuis ce numéro de la Revue belge du cinéma, cette hésitation à rassembler des films sous un nom d'auteur a disparu chez ceux qui l'avaient eue un moment: les collections à destination des élèves et des étudiants, les colloques (Lumière, Lang, Renoir...) se sont succédés depuis dix ans sans que personne n'en éprouve le moindre embarras.
Laissons de côté cette évolution et arrêtons-nous un instant sur ce moment où l'esthétique du cinéma ou la critique exprime des besoins qui ne collent plus avec les développements sémio-narratologiques récents, pour remarquer que cette contradiction n'est pas nouvelle, puisqu'elle est au coeur même de celui qui contribua à tuer l'auteur. Dès 1969, en effet, Michel Foucault reconnaît qu'il est victime d'une contradiction: bien qu'il vise à analyser, dans Les mots et les choses, "des sortes de nappes discursives, qui n'étaient pas scandées par les unités habituelles du livre, de l'oeuvre et de l'auteur", il ne cesse de recourir à des noms d'auteur (Buffon, Cuvier, etc.). (2) Ce paradoxe identifié, la question n'est plus d'évacuer le nom par un subterfuge - initiales ou autre - mais de comprendre ce qu'on met derrière. C'est dans cet esprit que le philosophe pose brutalement cette question: "Qu'est-ce qu'un auteur?", plus attentif d'ailleurs aux écrivains qu'aux autres, ce qui, soit dit en passant, ne fait que réaffirmer cette primauté du littéraire sur la constitution du champ des productions humaines (en français, précise le Dictionnaire Historique de la Langue Française, auteur signifie absolument écrivain).
 |
L'auteur, répond d'abord Foucault, apparaît dans notre culture à partir du moment où l'on se met à attribuer des textes à une individualité. Cette procédure d'attribution est corrélative d'une conception de l'oeuvre, qui sélectionne, choisit ce qui dans les traces laissées par quelqu'un, constituent son oeuvre, précisément. Cette opération apparaît comme particulièrement hasardeuse au cinéma pour des raisons qui tiennent à la nature même de l'oeuvre cinématographique. A cet égard, le début du cinéma est un terrain favorable pour observer le processus dans l'oeuf. |
Comment le film prend-il le statut d'artefact? Dans quelle tradition artistique se situe-t-il? A quel type d'oeuvre s'apparente-t-il? L'hypothèse que je développerai dans les pages qui suivent est que la difficulté de cerner et de définir la figure de l'auteur tient largement à l'hybri-dation des oeuvres qu'il produit. Mais, commençons par le commencement et observons la naissance de l'auteur de cinéma...
On admet volontiers, du moins dans le champ artistique, qu'un auteur se définit par le fait de produire un artefact avec une intention donnée. Ce qui, par exemple, différencie, pour Arthur Danto, une boîte de soupe Campbell ou de cirage Brillo d'une oeuvre de Wahrol ne réside pas dans les propriétés visuelles des objets - ils ont les mêmes - mais dans le fait que la seconde est "à propos de quelque chose": elle possède un aboutness que lui confère son intentionalité artistique et qui l'éloigne, quelle que soit sa nature, de l'objet réel qui lui ressemblerait trait pour trait. Genette va plus loin en affirmant que ce qui compte dans un ready-made, ce n'est "ni l'objet proposé en lui-même, ni l'acte de proposition en lui-même, mais l'idée de cet acte". (3) Que les discussions sur la nature de l'art, qui continuent d'alimenter maints ouvrages, se soient focalisées sur le scandale qu'ont pu représenter les objets exposés par Duchamp ou par Wahrol aurait dû susciter plus d'écho chez les esthéticiens du cinéma. Car si l'art moderne marque une rupture en proposant du banal à un monde de l'art qui le transfigure, le cinéma naît dans cette banalité et son premier combat est de trouver les voies de sa transfiguration. Il faudra plus de vingt ans pour qu'Aragon, deux ans après que Duchamp eut exposé sa roue de bicyclette, remarque: "à l'écran se transforment au point d'endosser de menaçantes ou énigmatiques significations ces objets qui, tout à l'heure, étaient des meubles ou des carnets à souche". (4) Delluc, de son côté, s'émerveille devant la "beauté de l'auto, du train, du paquebot, de l'avion [qui] justifie enfin [...] les poètes". (5)
Auparavant, le cinéma n'appartient pas au monde de l'esprit ou de la pensée, si l'on préfère, qui est l'horizon supposé par Danto quand il définit l'oeuvre par l'intention et par Genette quand il renvoie à l'idée. Contrairement au geste de Duchamp qui intervient dans le contexte d'une peinture et d'une sculpture qui ont rejoint depuis près de deux siècles les arts libéraux, le cinéma est, pendant deux décennies au moins, du côté des arts mécaniques. Doublement, pourrait-on dire. Entré de plain-pied dans l'ère de la reproductibilité, il est surtout, et avant tout, un art de la mécanique au sens propre, en sorte que lui manque d'emblée cette humanité qui lui conférerait la pleine valeur d'artefact et qui faciliterait la transfiguration du film en oeuvre.
Le mythe fondateur du cinéma, avec ses spectateurs qui s'écartent pour ne pas se faire écraser par des locomotives ou des tramways fonçant vers eux, ne met l'emphase que sur le premier aspect pour le tirer parfois à contresens. L'effet de réalité agit moins par comparaison ou par analogie avec son modèle que par le sentiment qu'il produit d'une continuité entre l'écran et la salle, c'est-à-dire de l'absence d'une instance médiatisant la relation entre l'image et celui qui la regarde, le faisant douter de son propre statut: acteur ou spectateur? "Plus de séparation, plus de vide, plus d'absence: on entre dans l'écran, dans l'image virtuelle sans obstacle. [...] De même il n'y a que dans la séparation stricte de la scène et de la salle que le spectateur est un acteur à part entière. Or tout aujourd'hui concourt à l'abolition de cette coupure". (6) Cette remarque de Baudrillard sur notre actuelle situation s'appliquerait tout aussi bien à ceux qui découvrent le cinéma à la fin du XIX' siècle. Un aujourd'hui qui ne date pas d'hier...
L'impression physique - à prendre évidemment avec des pincettes - importe moins toutefois que cette continuité sémantique qui nous fait reconnaître dans la "vue" (au double sens du mot) la banalité de notre monde, livrée telle quelle, sans que personne ne s'interpose entre elle et nous, comme le dit en substance Bazin. Rien n'est plus étranger au spectateur de 1900 que rapprocher les bandes Lumière de Poussin, Velazquez ou Chardin - comme le fait Aumont. (7) Comment renverraient-elles à des peintres, alors qu'elles ne sont même pas auteurisées? Loin de s'ancrer dans des êtres qui nous ressemblent, ces traces ne sont que la pellicule du monde dans toute sa banalité, et s'il y beauté, ce n'est qu'à celui-ci qu'elles le doivent, comme l'attestent de nombreuses publicités de l'époque qui vantent la beauté des films en évoquant celle des sites filmés.
A cet égard, la réception du film se rapproche bien de celle de la peinture, à condition de préciser qu'il ne s'agit ni de cette histoire de la peinture réduite par la doxa à celle des grands peintres, ni d'un regard savant sur les tableaux. Faut-il rappeler que Poussin lui-même, cité il y a quelques lignes comme modèle du peintre, jaugeait encore la qualité de l'oeuvre à l'aune du sujet (8) et qu'il ne faisait en cela que témoigner, certes un peu tardivement, d'un mode de réception qui fut majoritaire jusqu'à l'implantation de ce que Nathalie Heinich nomme "l'intellectualisation du regard", et dont le cinéma est l'héritier ?
Un mode de réception qui oublie l'auteur au bénéfice de ce qu'il a représenté. La beauté naturelle transite jusqu'au spectateur en sorte que les images prennent l'allure d'une trace, d'une empreinte, et non d'un artefact. Or, à y regarder de plus près, cette impression ne découle pas uniquement de la nature du cinéma; la peinture la provoque déjà, presque dans les mêmes termes: "Choisissez un site - dit Diderot à propos de Vernet -, disposez sur ce site les objets comme je vous les indique et soyez sûr que vous aurez vu ses tableaux". (9) Là comme ailleurs, le cinéma entretient des liens profonds avec la peinture, moins pour le parallélisme de ces effets - cadre, couleurs, lumière -, moins pour l'analogie de leur dispositif, en un mot: pour sa relation à l'oeil, à la vue et à la vision, que pour sa relation à la main, dans laquelle on doit chercher le statut de l'auteur de film.
En quelque vingt ans, le cinéma va vivre en accéléré l'évolution de la peinture du Moyen Âge au XVII' siècle. Dans ces deux premières décennies, en effet, on décèle très bien les trois moments qui mènent du peintre à l'artiste: "le pôle du métier, qui indexe la rétribution sur le critère matériel et stabilisé du produit, le pôle de la 'profession' ou de 'l'office', qui l'indexe sur le critère relativement attendu de la personne, et le pôle de 'l'art', qui l'indexe sur le critère fluctuant, immatériel et personna-lisé, du renom acquis par le créateur". (10)
Au "pôle du métier" correspond ce moment - quelques siècles pour le peintre, un peu plus d'une décennie pour le filmeur - où l'exécutant est payé au mètre, de surface peinte ou de pellicule impressionnée, et en fonction du sujet représenté. Au début du XVII' siècle une histoire profane vaut 85 000 livres et une histoire sainte 150 000. Une scène de genre 50 000, tandis qu'une nature morte ne vaut que 5000. Le cinéma des premiers temps connaît, de même, une cotation des films selon les genres, comme l'atteste cette annonce relevée dans Ciné-Journal, qui se livre à une arithmétique simple: "Nous louons 5 francs les 300 mètres comprenant soit un grand Drame, soit un beau drame et une comédie". (11) La classification des images selon Méliès - avec les images naturelles au plus bas de la hiérarchie et les images composées au sommet fait d'ailleurs écho à la valorisation au décuple de la "scène de genre" par rapport à la nature morte. Dans les deux cas, le sujet prime.
A ce stade, celui qui fait l'image est à peine un auteur puisque l'autorité du client l'emporte sur la sienne propre: le commanditaire ordonne au peintre de reprendre tel ou tel détail du tableau, (12) le chirurgien ne considère pas celui qui filme son opération comme un auteur. (13)
| Avec le pôle de la profession surgit la revendication du talent. "Les peintres réclament, avec plus ou moins de raison, que leur art soit payé non seulement sur la quantité de travail nécessaire, mais plutôt selon le degré de leur application et de leur expérience". (14) N'entend-on pas dans cette revendication, dont l'archevêque de Florence se fait l'écho dans, dans la première moitié du XV' siècle, cette autre des auteurs de scénarios que les "oeuvres représentées cinématographiquement seraient payées non plus forfaitairement, au mètre de positif par les éditeurs, mais bien par les exploitants, à chaque représentation des films sur l'écran". (15) A ceci près que le propos s'applique aux auteurs de théâtre. |  |
C'est d'ailleurs ce que remarque M. Ducroix, que Ciné - Journal qualifie d' "un de nos plus distingués metteurs en scène". Opposant les auteurs "directement intéressés" (Zecca et les autres) aux "auteurs dramatiques", il s'exclame: "Vous devez vous attendre à cette résistance, ne pouvant supposer que tous les auteurs et metteurs en scène cinématographiques n'étant pas syndiqués ni sociétaires [...] vont de gaîté de ccx.ur céder la place à vos auteurs qui, dans notre métier, jusqu'ici n'ont encore rien prouvé". (16)
On ne peut mieux dire: l'auctorialité doit revenir à celui qui "prouve" quelque chose par son talent, assimilé cette fois à celui qui met en images. Comme le peintre, qui, à ce stade de l'évolution de son activité, substitue la rémunération à la pièce à un traitement annuel, à une pension, le metteur en scène cinématographique est alors engagé par "l'éditeur". A ce moment, l'auteur est bien, selon sa définition étymologique, celui qui augmente la confiance, c'est-à-dire celui qui vend, le vendeur, et le médiateur - bien qu'il lutte pour le droit à sa reconnaissance -, s'efface derrière celui qui le paye et qui assure la commercialisation de son oeuvre.
Seul le troisième pôle met en avant la singularité d'un nom, attesté par sa signature, et l'unicité d'un homme connu par sa biographie et ses interviews. Il correspond précisément à cette fonction-auteur qui, au cinéma comme en littérature, permet à un individu de s'approprier une oeuvre, période qui coïncide, dans un cas comme dans l'autre, au moment où surgit la question des droits d'auteur. C'est seulement quand l'artiste commence à émerger comme figure unifiante et identifiée que la copie devient une pratique condamnable: notons que le mot "plagiat" n'apparaît que vers 1760, à l'aube de la figure romantique de l'auteur, et qu'il n'a des sens au cinéma que pour celui qui précède ses confrères dans la constitution d'une identité auctoriale: Méliès.
Mais revenons à cette primauté de la main qui, j'en formule ici l'hypothèse, conditionne le statut du cinéma des premiers temps, bien plus que le mimétisme quasi obligé et automatique de la photographie (Méliès vient d'ailleurs en renfort, lui qui affirme: "Je suis à la fois un travailleur intellectuel et un manuel. Le cinéma est intéressant parce qu'il est avant tout un métier manuel.") Trace de la réalité comme la photographie, ce cinéma, en effet, par l'organisation de son travail et la hiérarchie de ses métiers évoque bien plus la gravure, elle aussi née de l'empreinte, et le studio des premiers cinéastes n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'atelier du graveur de la Renaissance. Qu'on en juge: "Au bas des anciennes gravures, on pouvait lire: X pinxit, invenit, delineavit componit ou figu-ravit, Y fecit, indicit ou sculpsit, Z excudit ou impressit. Cette hiérarchie des signatures trahit bien la ségrégation qui présidait à l'organisation de l'atelier classique: au centre le patron, producteur d'idées, et entouré d'aide, souvent réduits au rôle subalterne d'exécutants". (17) Les "vues composées" obéissent bien à ces trois fonctions: tout en haut celui qui a l'idée, l'auteur dramatique ou le scénariste, au milieu, ceux qui font, en l'occurrence soit les interprètes, les comédiens, et ceux qui impriment ce qu'ils voient, les tourneurs de manivelle, au bas de l'échelle.
Tous les efforts de ceux qui, par ailleurs, luttaient pour la reconnaissance de leur travail, les "auteurs et metteurs en scène cinématographiques", visaient à ramener celui qui invente au studio (invenit), mais non à changer véritablement cette hiérarchisation qui accordait, pour le film comme pour la gravure, le privilège auctorial à l'inventeur de l'idée et à dénier toute auctorialité, en revanche, au responsable de l'impression de l'image (sur le papier ou sur la pellicule).
Si donc, à l'origine, le cinéma emprunte à la peinture, ce n'est pas à cette activité libérale, libérée et intellectualisée qu'elle devient tardivement, mais à cette "usine à image" qu'était l'atelier soumis à cette malédiction de la main, condamnée au manque, simple exécutante de l'esprit d'un autre et soumise à l'autorité de son donateur ou de son ordonnateur. Pourquoi le cinéma, contemporain de l'impressionisme, revient-il à une idée du peintre et de la peinture antérieur au romantisme? Cette question ne se pose en fait que si l'on réduit l'histoire à de simples coupes temporelles où la synchronie dicte sa loi, et que l'on tire de la concomitance une série d'influences ou de connivences: le cinéma et la psychanalyse, le cinéma et l'impressionisme, etc. De même que, comme je l'ai montré ailleurs, (18) le cinéma est plus proche d'un modèle populaire du cerveau, du rêve et l'hallucination, que de la théorie de l'inconscient, il revit, avec quelques siècles de retard, la condition des arts mécaniques, tout simplement parce qu'il est d'abord senti comme une activité manuelle. Mais pas n'importe laquelle: plutôt du côté des arts du décor que des arts du dessin. Comme on sait, cette opposition permettait encore d'établir une gradation entre les spécialités des imagiers. Bien qu'ils fussent tous rabaissés par rapport aux arts libéraux, les arts mécaniques n'étaient pas tous au même niveau: "dans le contexte de dévalorisation du 'manuel' par rapport au 'spirituel' - insiste N. Heinich -, un certain privilège s'attachait à toute technique qui, en engageant une main - plutôt qu'une multiplicité de mains anonymes ou, pis, des machines -, manifestait la prééminence du geste (coup de crayon ou de pinceau) sur l'action mécanique (fusion, pression, tissage), de l'organe (main, oeil) sur l'outil (four, marteau, métier à tisser) et, par là-même, de la personne sur la matière, de l'humain sur l'inanimé, de l'unique sur le répétitif. Une frontière séparait les 'procédés d'expression directe' des autres techniques, relevant principalement de ces critères matériels que sont la dimension, le coût des matériaux et la main d'oeuvre". (19) Pour tous ces raisons, les tapissiers, brodeurs, ébénistes, bronziers d'ameublement, etc. étaient dévalués par rapport à ceux qui faisaient directement des images: les peintres.
 |
On s'explique sans mal, dans ces conditions, que les divers métiers qui participent à la confection des "vues naturelles" comme des "vues composées" se rapprochent plus du statut des arts du décor que des arts du dessin. Le geste de celui qui tourne la manivelle doit perdre toute individualité jusqu'à devenir mécanique, répétitif pour être parfait. Le paradoxe du tourneur est que son habileté manuelle doit tendre à une perfection qui fait oublier sa main et qui s'approche à tel point de la machine qu'on peut lui substituer tout tourneur aussi habile que lui. En témoigne le fait que, pendant tout le cinéma muet, l'expression "tourneur de manivelle", parfois transformé en "tourneur de moulin à café", aura une connotation fort péjorative. (20) |
Quant aux films tournés en studio, par le rôle déterminant qu'ils donnent aux toiles peintes, dont Méliès rappelle les grandes difficultés d'exécution, aux meubles et aux différents trucs dont ils sont l'objet, aux costumes, ils sont à la fois du côté des arts du décor et de la décoration médiatisée, et ne jouissent pas, à ce titre, de ce relatif privilège que l'on confère à l'expression directe. On ne s'étonne pas, dans ces conditions, qu'ils ne suffisent donc pas à élever au rang d'artiste ceux qui les exécutent.
Gravure, dessin, exécutant, interprète, copie... Derrière ces mots, surgis au cours de cette approche historique, pointe en filigrane une autre problématique, plus philosophique, celle de l'autographie et de l'allographie. Rappelons que, pour Nelson Goodman, une oeuvre autographique se définit par la possibilité d'être copiée et par le fait que l'on peut, en droit, distinguer entre l'original et ses contrefaçons éventuelles. Avec l'oeuvre allographique, en revanche, l'idée même de copie perd son sens: copier l'oeuvre, c'est la refaire, Autant il est possible, par exemple, de refaire des faux Rembrandt ou des faux Vermeer (on ne s'en est pas privé), on ne peut copier rigoureusement la Recherche du temps perdu sans la refaire du même coup, et on peut la proposer au lecteur dans de multiples typographie sans changer l'oeuvre pour autant. Chez le philosophe américain, l'allographie est avant tout liée à l'existence d'un système notationnel qui permet à divers exécutants de rejouer l'oeuvre sans pour autant la modifier ou la contrefaire: on peut certes faire passer une exécution pour une autre - présenter le Concerto à la mémoire d'un ange comme un enregistrement pirate de Menuhin, alors qu'il est joué par mon oncle -, mais cette tromperie sur l'interprète n'est pas pour autant une copie de l'oeuvre de Berg.
Pour qualifier ces systèmes notationnels qui permet- tent d'identifier l'oeuvre diversement interprétée, Goodman emploie le mot "partition", qu'il définit ainsi: "Une partition, qu'on l'utilise ou qu'on s'en passe pour conduire une exécution, a pour fonction primordiale d'être l'autorité qui identifie une oeuvre, d'exécution en exécution". (21) Bien que la réflexion du théoricien ne traîte pas ouvertement de cette question, elle trace néanmoins une frontière entre deux types d'auteur: l'auteur autographique et l'auteur allographique, en supposant implicitement divers types de relation, plus ou moins lointaine, entre l'auteur et l'oeuvre.
Le peintre ou le dessinateur garde toujours une relation directe à son oeuvre. L'esquisse peut certes contenir en germe le tableau, mais elle ne définit pas une oeuvre au sens où elle délimiterait une classe d'exécutions; elle est une oeuvre, ne jouant pas comme caractère dans un langage notationnel. Dans ce régime autographique, l'authenticité ne se juge qu'en rapportant l'acte à son auteur, conçu comme cause efficiente, et entretenant donc une , relation indicielle à son objet.
A l'inverse, l'oeuvre du musicien est "libérée" de "sa dépendance à l'égard d'un auteur, d'un lieu, d'une date ou des moyens de production particuliers". (22) Ou, pour mieux dire, elle circule loin de lui et, néanmoins, avec l'assurance d'une permanence que fournit la notation. La partition définit son oeuvre, en déterminant la classe d'exécutions qui lui appartiennent (y compris lorsqu'il prévoit des parcours facultatifs comme chez certains compositeurs modernes). Inversement, elle est déterminée, de façon unique, par le système notationnel qui la régit: l'exécution n'est, pour Goodman, que l'exemplification de la partition. L'auteur est présent dans les différentes exécutions de son oeuvre sous la forme abstraite d'une autorité dont le pouvoir s'arrête là où commence la performance.
Dès que l'on se tourne vers les arts du spectacle - et, spécifiquement, de la scène - ces idées de l'auctorialité perdent de leur clarté. La performance théâtrale en tant qu'elle reprend les dialogues écrits par le dramaturge s'identifie plus ou moins à l'exécution d'une partition. En revanche, les indications scéniques, le jeu des acteurs, la descriptions des décors - les didascalies - sont plutôt des scripts. Dénotations d'objets non verbaux, "approximativement notationnels" (Goodman), ils laissent au metteur en scène sa marge de manoeuvre. Quant à la version cinématographique et muette du dialogue, voici ce qu'en dit Goodman: "Un script de cinéma [mieux vaudrait dire un scénario] n'est ni l'oeuvre filmique ni une partition pour l'exécuter mais, bien qu'on l'utilise dans le tournage d'un film, il est sous d'autres rapports dans une relation à l'oeuvre aussi vague d'une description verbale d'une peinture à la peinture elle-même". (23)
Comment définir alors le cinéma?
Goodman n'en dit pas grand-chose. Sans doute parce que, comme dit Genette, il appartient à la catégorie des "monstres multimédiatiques". Mélange de matières de l'expression multiples, il emprunte, à n'en pas douter, à plusieurs régimes.
En tant que photographie animée, il relève de la même logique que la photographie. De même que celle-ci, il se place du côté du "régime autographique multiple" (24) entendu avec Goodman comme art "dont les produits sont singuliers [seulement] en première phase". (25) En tant qu'empreinte, rencontre du monde et d'un sujet argentique, il est singulier; par les copies que l'on peut en tirer, il est multiple. Encore faudrait-il restreindre ces considérations à l'image canonique: certains films comme Arnulf Rainer (Peter Kubelka, 1957-1960), faisant se succéder des temps d'images noires et blanches, peuvent être refaits par quiconque possède la formule qu'en donne le découpage. Mieux: un film en images de synthèse, comme Toy Story, entièrement produit selon un système de notation numérique peut être exécuté par quiconque possède l'algorithme engendrant les images et il peut même circuler indépendamment de sa représentation visuelle sous forme de fichiers.
Ces deux types de films se prêtent parfaitement à ce test de concordance orthographique qui permet de s'assurer que l'exécution correspond aux propriétés de la partition qui l'engendre ou qu'elle répète. Contrairement à la gravure, dont les divers exemplaires ne peuvent être vérifiés en fonction de ce test.
| Sur son versant scénique, celui de la performance d'acteur, le cinéma est encore du côté de l'autographie, puisqu'il reproduit, puisqu'il capte l'identité numérique d'une performance, à tel point unique que le réalisateur, avant le montage, choisira la prise qu'il préfère. Cette unicité est cependant contestable: le jeu de l'acteur - et notamment le jeu de tel acteur connu - est souvent codifié au point que les différentes performances constituent une série de gestes si souvent répétés qu'ils en deviennent imitables. Que l'on pense à Charlot et à ses multiples imitations ou à Louis de Funès, imitation de lui-même: la contrefaçon est affaire de costume et de maquillage, | 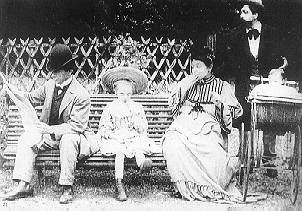 |
Et la mise en scène? Genet te admet comme Goodman qu'elle échappe partiellement à la notation. Cependant, pour la théoricien français, la notation est, certes, un indice de l'allographie, (26) mais elle ne saurait constituer une condition nécessaire: d'une part, "il n'est nullement nécessaire de savoir lire la musique pour reproduire d'oreille une phrase musicale"; (27) d'autre part, toute oeuvre peut faire l'objet, un jour ou l'autre, d'un système de notation, y compris un plat pour un critique gastronomique habile à en reconstituer la recette, (28) en sorte que, comme l'affirme Goodman, l'autographie n'est jamais qu'un stade d'évolution artistique antérieur de l'allographie. Mais, surtout, Genette affirme que, en dépit de la difficulté de notation qu'elle pose, elle s'offre à la (dé)notation, concept qu'il va substituer à la "partition" goodmanienne. Contrairement à celui-ci, qui considère "l'oeuvre allographie comme une simple collection d'occurrences ou d'exemplaires ('répliques') non totalement identiques, mais qu'une convention culturelle pose comme équivalents", Genette voit mal "en quoi consiste cette équivalence sans faire appel à quelque idéalité, fût-ce sous les termes de 'propriétés constitutives', d"identité littérale' (sameness of spelling) ou de 'conformité' (compliance) d'une exécution à une (dé)notation", (29) en sorte qu'on peut concevoir l' oeuvre allographique comme un "objet de pensée que définit exhaustivement l'ensemble des propriétés communes à toutes les manifestations". (30) Cet objet "idéal" est constitué par la réduction allographique, opération qui "a lieu à chaque fois qu'un acte physique (mouvement corporel ou émission vocale) est 'répété' ou qu'un objet matériel est reproduit autrement que par une empreinte mécanique", (31) et qui consiste à ramener "un objet ou un événement, après analyse et sélection, aux traits qu'il partage, ou peut partager, avec un ou plusieurs objets dont la fonction sera de manifester comme lui sous des aspects physiquement perceptibles l'immanence idéale d'une oeuvre allographie". (32) Autrement dit, qu'une exécution déborde largement son système de notation n'empêche pas de la considérer comme l'une de ses manifestations: que Mozart, après avoir écouté le Miserere d'Allegri à la Chapelle Sixtine, rentre chez lui et note tout ce qu'il a entendu ne signifie pas, pour Genette, qu'il a transcrit toutes les nuances de l'interprétation, mais seulement qu'il a réduit l'oeuvre à ses "propriétés constitutives". (33) En ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles n'existe pas un système strict de notation (contrairement à la musique et, en certains cas, à la chorégraphie) désignant les moyens verbaux ou autres qui permettent de prescrire l'exécution d'un objet d'immanence, Genette préfère parler de dénotation plutôt que de notation, "puisqu'il s'agit à chaque fois d'établir, par un moyen ou par un autre, et généralement conventionnel, de représentation, la liste des propriétés constitutives de cet objet idéal". (34)
La relation de la pièce à la représentation théâtrale, du scénario au film, n'est plus donc aussi vague que pour Goodman, puisque les didascalies constituent un système de dénotation en prescrivant l'exécution, même si "les scripts verbaux chargés de 'noter' des objets non verbaux, comme les didascalies dramatiques ou les recettes de cuisine, souffrent (à cet égard) de toutes les équivoques et de tous les glissements progressifs propres au 'langage discursif': si une didascalie prescrit 'fauteuil Louis XV' sans préciser la couleur, le metteur en scène ne pouvant respecter cette alchimie, met par exemple un fauteuil Louis XV bleu". (35) Genette propose le schéma suivant: (36)
Immanence mise en scène
Manifestation représentation -----------didascalies
Comme on le voit à la lecture de ce schéma, l'oeuvre mise en scène est pour partie allographique, pour partie autographique. Le côté droit, celui de la "dénotation", suppose que les diverses versions d'une pièce, les diverses mises en scène peuvent être plus ou moins notées et, donc, rejouées, et, en fin de compte, que les différences inévitables d'un soir à l'autre, ne vont pas au-delà de ce que l'on juge acceptable au nom de la réduction allographique. Le côté gauche, en revanche, laisse à la représentation, performance singulière d'une troupe d'acteur, sa part d'autographie.
Doit-on admettre avec Genette que la relation de dénotation à l'immanence idéale de la mise en scène est suffisamment prescriptive pour engendrer une série d'exécutions équivalentes ou doit-on accepter la conception plus restrictive de Goodman, qui subordonne (malgré ce qu'en dit Genette) l'allographie à la notation? Pour répondre à cette question, il ne me semblerait pas inutile de soumettre l'oeuvre à un test de réversibilité: la mise en scène tirée des didascalies est-elle équivalente à ce que l'on note dans l'après-coup pour la conserver? Sans doute pas, et Genette l'admet. Peut-on, quand même, malgré cette restriction, traiter la mise en scène selon le régime allographique? La question mériterait un long débat qui m'éloignerait de mon propos et je me contenterai donc de revenir au champ dont je suis parti, le cinéma des premiers temps, pour constater qu'il penche pour Genette. Si l'on pense avec lui que le régime allographique est moins ontologique qu'affaire de convention culturelle et d'usage, et qu'il n'existe pas d'oeuvres allographique sans art allographique, force est de constater que le film est d'abord reçu comme une oeuvre allographique (même si cette hypothèse va à l'encontre de la lettre goodmanienne, qui veut que l'autographie précède l'allographie).
Les diverses versions des vues Lumière - par exemple, les trois versions de La sortie des usines - ne sont pas considérées comme des copies par le spectateur de 1900, ce qui leur conférerait un statut autographique, mais comme des bandes interchangeables ou équivalentes (d'ailleurs, il n'en va guère autrement aujourd'hui pour l'ensemble du public, hors spécialiste). Quant aux vues composées, on sait que pendant plusieurs années, les scénaristes déposaient leurs "scripts" aussi bien pour le théâtre que pour le cinéma, ce qui atteste que les différences matérielles entre pièce et mise en film n'étaient pas tenues pour pertinentes et que le scénario était, plus encore que pour les mises en scène, une idéalité. Il n'en est de meilleure illustration que cette exclamation de Delluc, à la vision de La Dixième symphonie: "Voici un film qui n'aurait pu être exécuté par un autre quelqu'un puisque son auteur s'y manifeste en tout". (37) On ne peut mieux dire... et dans les termes goodmaniens!
La naissance du cinéaste coïncide avec ce moment où le film est pensé comme une activité autographique. Avant, le filmeur ou le compositeur de vue n'est qu'un exécutant anonyme et substituable d'une immanence idéale qu'est la pièce de l'auteur dramatique ou le scénario de l'auteur cinématographique. Certains, sans doute rares, vont même jusqu'à penser que le film relève de la notation: "Cinematography is a form of notation by image, as arithmetic and algebra are notations by figures and letters". (38) Pendant près de deux décennies, l'autographie du film n'est donc perçue que dans la performance de l'acteur, d'où sa prééminence dans les publicités. Ou, peut-être même, et plus fréquemment, des aventures d'un personnage récurrent, disons Rigadin, déplaçant l'auctorialité de l'amont du film à sa manifestation cinégraphique. A n'en pas douter, il y a dans le cinéma des premiers temps, cette idée que, comme le dit le scénariste de Sunset Boulevard, les personnages sont les vrais auteurs du scénario. L'enregistrement visuel n'enlève rien à l'autographie de la performance et n'y ajoute rien non plus - le film est une oeuvre autographique multiple, selon la définition de Genette, parce qu'il est réduit au comédien ou à son versant fictif, et non parce qu'il définirait une façon de voir le réel, unique au point d'être irréductible à une simple exécution.
Pour l'instant, nous avons considéré le film en tant que tel, hors contexte, comme manifestation visuelle mécanique, sans prêter attention à ce qu'il devient lorsqu'il est projeté dans la salle. Spectacle bonimenté, il subit deux transformations majeures. La présence - et, même, la prégnance - d'un texte oral prononcé dans la salle, donne à l'activité narrative une prééminence: d'activité mécanique, soumise à la main, le film devient un récit, prescrit et organisé par la liberté du logos, en sorte qu'il glisse un peu plus encore vers l'autographie que lui confère la singularité de cette performance d'acteur dans la salle. Le spectateur se retrouve, finalement, dans une situation qui n'est pas sans rappeler l'auditeur de l'aède antique ou du trouvère médiéval. La chanson de Roland, par exemple, connue aujourd'hui par sept manuscrits, différents par leur date, leur dialecte, leur versification, est une "oeuvre fondamentalement mouvante", comme le note Zumthor, (39) dont les versions écrites que sont les textes d'aujourd'hui ne sont que les états d'une oeuvre qui est à la fois "en dehors et hiérarchiquement au-dessus de ses manifestations textuelles". Les catalogues relatant les histoires des premiers films fixent un état de l'oeuvre dont chacune des interprétations bonimentées, laissant libre cours à l'imagination du "conférencier" peut être considérée comme une version, malheureusement perdue. L'autographie se mesurant largement à l'aune de l'improvisation, on peut imaginer combien, soumis à une parole émanant du même lieu que le spectateur - avec le pouvoir d'ancrage que la sémiologie a mis en évidence - ce récit devait contribuer à construire à ses yeux un véritable auteur (de même que, aujourd'hui, l'auteur d'un reportage du Journal télévisé apparaît d'abord comme le journaliste qui commente les images). (40) Pour dire les choses en termes genettiens, qui conviennent fort bien en l'occurrence, on décrirait volontiers le statut des premiers films de la façon suivante: allographiques en tant qu'enregistrements du réel ou d'une performance conçue comme autographique, ils se présentent, en tant que spectacles, comme des oeuvres (le mot est sujet à caution) qui immanent en plusieurs objets n'apparaissant pas véritablement comme identiques et interchangeables en raison même de la performance en salle du bonimenteur. Pluralité d'immanence qui, comme ajoute Genette à propos de la chanson de geste médiévale, "s'accompagne d'une pluralité d'auteurs que signe, si l'on peut dire, l'anonymat de ce type d'oeuvre ou l'incertitude d'attribution que symbolise l'existence contestée d'Homère", (41) Dans ces conditions, l'identité auctoriale s'appuie à la fois sur la conviction de participer à une tradition du récit, dont le bonimenteur ne fait qu'allonger la série. D'où la présence, dans tous les cinémas des débuts, de la Passion, des légendes et des épopées médiévales propres à chaque pays. Rainer Rochlitz note que, "historiquement, la réduction 'allographique' en littérature serait à situer au moment du passage à la littérature écrite, voire à l'imprimerie, définissant l'identité de l'oeuvre, indépendamment de la voix du narrateur et de ses intonations, indépendamment aussi de la présence de ses auditeurs". (42) De la même façon, on pourrait formuler l'hypothèse que l'auctorialité du cinéaste naîtra avec le transfert du récit de l'autorité du bonimenteur - qui sait, comme l'auteur-vendeur déjà évoqué, vendre le film qu'il présente grâce à son boniment - à la médiation indéfiniment reproductible des cartons, Avec ces mots dans le film, celui-ci se stabilise, abandonnant cette mouvance que seule l'oralité, et les improvisations qu'elle permettait, favorisait. Ce n'est pas un hasard, évidemment, si l'arrivée des cartons est concomitante de la lutte des auteurs de scénarios pour être payés en fonction du succès. La parole circulant alors sous la forme allographique de l'écrit - à tel point allographique que se pose aujourd'hui, dans certains cas, la question de l'authenticité des cartons - l'auteur-vendeur est en quelque sorte repoussé en dehors de la salle, l'exploitant devenant, du même coup, un simple exécutant d'un spectacle pré-conçu, noté, et gravé dans la pellicule.
Ces développements convaincront, du moins je l'espère, que l'auteur d'un art allographique ne s'identifie pas à l'auteur d'un art autographique, conclusion sur laquelle ni Goodman ni Genette, dont ce n'est pas le propos, n'insiste. D'où vient leur différence. D'abord, je l'ai dit, du fait que dans le régime allographique l'autorité est, en quelque sorte, distendue de l'exécution de l'oeuvre, tout simplement parce qu'elle est médiatisée. Qui applaudit-on à une représentation de Don Giovanni? Mo-zart ou Van Dam? Mozart ou Lorin Maazel? Sans doute plus les seconds que les premiers. Cet exemple suggère que, lorsque nous sommes en présence d'arts qui mêlent régime allographique et régime autographique, les seconds l'emportent dans l'évaluation que nous en faisons, Don Giovanni mal joué sera sifflé, bien que Mozart n'en puisse mais. J'en donnerai l'explication suivante: ce qui valorise l'autographie, c'est le sentiment qu'à travers elle le corps, comme individualité unique et irremplaçable, s'y écrit. Le manuscrit de Madame Bovary vaut plus que son édition Garnier-Flammarion (bien qu'il soit bien plus difficile à lire) et l'on préfère aujourd'hui sentir la main d'un peintre qu'être face à un tableau trop "léché". C'est la revanche des arts mécaniques.
Qu'est-ce qu'un auteur de film, donc?
D'abord, une condition transcendantale qui permet de distinguer les films des objets naturels: c'est le stade de l'auteurisation. Ensuite, une instance variable selon qu'on ramène le film à son scénario, comme au tout début du siècle, et que l'on construit l'identité auctoriale comme une autorité médiatisée, selon qu'on l'ancre dans le jeu de l'acteur en réduisant la transformation apportée par l'enregistrement, ou qu'enfin on l'origine dans un corps particulier, celui du filmeur ou celui du supposé-réalisateur qui exerce un regard particulier sur le monde. (43) Apparus à des moments divers de l'histoire du cinéma ces différentes figures, allographiques, autographiques - auxquelles correspondent respectivement l'auteur adapté, le scénariste, et le scénario, le comédien, l'interprétation scénique, le supposé-réalisateur et le filmeur -, sont aussi trois façons, pour le spectateur d'aujourd'hui, de construire l'auteur.
Pour le "producteur", considérer l'auteur comme instance d'un régime allographique, c'est soit considérer que la caméra ne traduit pas un regard, mais une vue (les opérateurs Lumière), soit que le scénario est à tel point codifié, organisé selon un système de notation qui le rapproche de la partition, que l'exécutant cinématographique qui opère la mise en images est mineur: c'est Pathé ou Gaumont avec leurs divers metteurs en scène; c'est surtout le producer-unit-system, où le "director" était condamné, à de rares exceptions près, à suivre le scénario écrit par d'autres, et où le film, en certains cas, était repris par un nouveau director. Mais où le scénario lui-même, comme le tournage à venir, faisait l'objet d'un véritable système de notation. Non seulement on assiste alors à une standardisation du format du script, avec une organisation indéfiniment réitérable, mais aussi du maquillage lui-même, noté grâce à une "chart" qui décrit les surfaces de la peau et les produits à appliquer, pour mieux assurer une continuité entre les jours de tournage. De même, des schémas extrêmement précis prescrivent comme une vraie partition l'éclairage, la place de la caméra et les mouvements de microphone. (44) En sorte que le scénario est conçu comme une partition, bien plus que le croit Goodman, dont l'exécution par un metteur en scène ne change pas la nature profonde.
Si, donc, comme je l'ai avancé dans Un monde à notre image, la réception du film comme artefact suppose trois opérations - 1. l'auteurisation; 2. l'identification de l'auteur, passant notamment par l'attribution d'un nom; 3. l'identification d'une intention -, l'auteur n'est pas seulement un nom et lui substituer des initiales ne suffit ni à annuler sa fonction ni l'idée que l'on se fait de son autorité, plus ou moins médiatisée. Compte surtout, dans l'interprétation du film, cette oscillation entre l'attribution allographique et l'attribution autographique, Dire d'un film qu'il est de la Warner Bros ou de la MGM, c'est le replacer dans une série où aucune oeuvre ne se détache de l'autre, où aucune n'est, non plus, imitable ou contrefaisable, parce que toutes appartiennent à la répétition indéfinie d'un modèle sans commencement ni fin (comme en témoigne l'appellation, par exemple, "Série B"). L'attribuer à Mervyn Le Roy ou à Minnelli, comme le fait le cinéphile, c'est l'extraire de cette scénarisation conçue comme une partition, et postuler que ces deux "directors" ont marqué de leur individualité corporelle - regard, direction d'acteurs, vision du monde - l'enregistrement de la dénotation genettienne.
Historiquement, le processus d'attribution du film à un auteur a été long et fluctuant. Cette hésitation, on l'aura compris, tient d'abord à la pluralité des champs artistiques auxquels le cinéma a emprunté non seulement son langage composite, mais aussi la condition de ses artisans. On peut certes trancher la question de l'auteur du film par une affirmation péremptoire d'une hiérarchisation de ceux qui concourent à sa fabrication. Je préfère, quant à moi, penser que si l'auctorialité passe de main en main, ou d'une figure à l'autre, c'est parce que l'oeuvre cinématographique mélange intimement l'autographie et l'allographie, conçues non comme des réalités constitutives mais comme les usages qu'on en fait.